Le débat se poursuit sur la question de l’avenir du secteur aéronautique dans la région toulousaine.
Le 4 mai, le Manifeste de l’Industrie a répondu à l’hypothèse de « Toulouse, le syndrome Détroit ? » émise par la Fondation Copernic, Attac, les Amis du Monde Diplomatique et l’Université populaire de Toulouse, qui ont rebondi cinq jours plus tard. Le ping‐pong intellectuel continue avec cette nouvelle tribune.
Toutes les contributions – pour peu qu’elles soient argumentées sur le fond – sont les bienvenues pour enrichir cette discussion.
****
Des désaccords sur l’avenir de l’aéronautique et celui de Toulouse
Les quatre auteurs estiment que nous employons une formule qu’ils qualifient de « rhétorique » lorsque nous considérons la crise climatique et écologique comme une « opportunité historique ». Et d’ajouter que notre formule ou celle qu’ils nous prêtent « fleure bon la litote et probablement la politique institutionnelle… ».
Pour être plus précis, nous avons écrit : « La question de la crise climatique et, plus largement, celle de la crise écologique, loin d’être une contrainte de plus qu’Airbus et l’industrie aéronautique dans son ensemble auraient à affronter, est une opportunité historique. Elle doit être saisie de façon urgente et à moyen/long terme ».
Cette crise sanitaire est d’abord un désastre. Si d’un désastre peut encore surgir le pire, le pire n’est jamais sûr et il revient au mouvement social d’imaginer les alternatives. En résumé, ces alternatives rassemblées peuvent dessiner un nouveau modèle de développement. Développement que nous ne confondons nullement avec une croissance productiviste dont les méfaits sur les humains comme sur la nature ne peuvent plus être ignorés.
Nos amis écrivent : « Il faut réorienter l’appareil productif mais aussi l’ensemble des budgets publics pour tenir compte de la nouvelle donne issue de la pandémie et de la crise économique et sociale qui lui est associée. Mais il faut le faire sur les bases d’une prise en compte de la crise climatique qui exige de penser autrement le développement des territoires ; pouvons‐nous même encore parler de développement tellement cette terminologie semble aujourd’hui caduque ? »
Nous pensons que nos amis confondent, il est vrai comme beaucoup, croissance et développement. Nous considérons pour notre part que le concept de « développement » ou de « modèle de développement » n’est nullement caduc. Une distinction essentielle qui mériterait autre chose qu’une simple incise …
L’avenir du transport aérien
S’agissant du transport aérien, si nous sommes d’accord sur le constat des dégâts multiples causés par les compagnies low‐cost (nous y reviendrons), nous sommes en désaccord lorsque les quatre auteurs écrivent : « Il y aura toujours des clients pour le transport aérien touristique, mais des clients dotés d’un bon (haut ?) niveau de revenus. Et leur nombre n’aura rien à voir avec celui des touristes actuellement transportés partout sur le globe. Il y aura donc beaucoup moins de passagers et qui paieront beaucoup plus cher. Voyager en avion redeviendra un luxe réservé à ceux qui en auront les moyens et on reviendra aux aéroports d’avant « remplis » d’hommes d’affaires (enfin, ceux qui ne seront pas en télétravail…) et de « riches » ».
Nous avons écrit et maintenons : « Si l’arrêt ou un fort reflux du tourisme de masse peut entraîner une modification profonde des modèles low‐cost des compagnies aériennes, cela ne devrait pas signifier la fin du tourisme sur la planète, mais un autre tourisme, plus respectueux des humains comme de la nature ». La perspective que nous défendons et que nous considérons comme crédible n’est pas celle d’un retour aux années 30 ou même 50 d’un transport aérien réservé aux classes les plus aisées. Notre perspective est donc bien celle d’une mutation, non celle d’un recommencement, d’une simple reprise, toute chose égale par ailleurs…ou presque, en pire.
« Un séjour touristique contre un enfant affamé ? Drôle de choix quand même ». Bien que nous ayons du mal à comprendre ce que fait cette proposition dans le texte des quatre auteurs pour démontrer les effets du tourisme de masse, nous préciserons que si ce dernier s’est accéléré avec les compagnies bas‐coûts, ces compagnies ne représentent, en 2018, que 21 % du volume de passagers transportés par les compagnies aériennes mondiales. Certes, ce volume était de 11 % en 2004.
Ainsi, contrairement à l’image que l’on peut en avoir, le trafic aérien reste majoritairement dû aux compagnies « traditionnelles » et le développement du transport aérien est loin d’être uniquement basé sur celui du tourisme, a fortiori low‐cost.
Nous réaffirmons, cependant, qu’un autre tourisme, profondément différent des formes de tourisme actuel « de masse », est possible et souhaitable.
Les quatre auteurs estiment que nous manquons de « lucidité » et sommes « dans le déni » lorsque nous écrivons qu’« avec un carnet de commandes de huit ans de production, l’avenir d’Airbus ne semble pas compromis ». Et lorsque nous indiquons que « la situation actuelle, en dépit de la contraction des cadences ne ressemble en rien à la mise à mort de l’industrie aéronautique ».
Scénario sombre ou rebond ? 5 000 avions de moins à livrer sur cinq ans, ce n’est évidemment pas rien. Cependant cette contraction est‐elle conjoncturelle ou structurelle ? La perspective reste celle de livrer 35 000 avions nouveaux d’ici 2040, soit un peu plus de 850 avions par an pour Airbus et autant pour Boeing. Certes, Airbus s’est dimensionné pour livrer plus de 900 avions par an et il faudra, à l’évidence, recalibrer les cadences prévues à la baisse. Mais le niveau de commande en cours qui demeure reste très important. À court terme, l’essentiel va être de gérer au mieux, c’est-à-dire en préservant la situation des sous‐traitants et celle des personnels intérimaires, les reports de livraison. Mais rien ne justifie un scénario structurel de plusieurs milliers de suppressions d’emplois dans la sphère toulousaine. Ce scenario peut et doit être évité et les pouvoirs publics doivent pleinement s’engager en cela avec des mesures que nous rappelons plus loin.
Nous maintenons donc notre position, celle d’une configuration qui ne ressemble en rien à la mise à mort du secteur, en rappelant une nouvelle fois que l’avenir d’Airbus et de l’aéronautique à Toulouse et dans le monde, ne se jouera pas sur les volumes mais sur la qualité des avions : des avions moins nombreux, plus sobres et mieux utilisés, c’est-à-dire utilisés sur des distances qui ne peuvent être courtes, comme cela est le cas, par exemple, actuellement entre Toulouse et Paris (à condition que les investissements ferroviaires soient effectivement réalisés).
Nos amis pensent‐ils autre chose lorsqu’ils écrivent : « La montée en puissance des exigences en termes de respect de l’environnement et de sobriété énergétique liées à la prise en compte de la crise climatique a déjà commencé à impacter le secteur » ?
Nous maintenons que « la qualité » des nouveaux avions – correspondant aux nécessités qu’impose la transition écologique – pourrait compenser à terme la baisse du volume des avions vendus ».
La place des autres secteurs dans la région toulousaine
Nous avons effectivement écrit : « Il est erroné de considérer qu’en dehors de l’aéronautique, Toulouse et sa région ne peuvent faire reposer leur développement économique que sur des « micro‐ secteurs ». Pour rester dans le domaine industriel, l’espace, les systèmes embarqués, l’électronique automobile, l’informatique, l’intelligence artificielle, sans oublier l’agroalimentaire, la mécanique, la chimie, la chimie fine et pharmaceutique et le textile ne sont pas des « micro‐secteurs » en région toulousaine. Il est peu entendable de considérer que ces activités mettront des « dizaines d’années pour constituer une alternative ».
Et nos amis de rappeler, pour nous contredire sans doute, ce qu’ils désignent comme des faits têtus : les désastres industriels qu’ont été Elf Biotechnologies de Labège, ancêtre de Sanofi, Sanofi lui‐même, Freescale, Storage Tek… Et de conclure : « Si nous parlions d’Hyperloop à Francazal ? Un futur désirable, vraiment ? ».
Si les désastres que nos amis évoquent avec raison ont de quoi faire réfléchir quant à leurs causes, ils n’obèrent pas l’analyse que nous faisons des secteurs que nous avons évoqués en ne souscrivant pas à l’idée que ce sont des « micro‐secteurs ». Ces secteurs sont des secteurs d’avenir et ils doivent être promus, comme doit être promue l’industrie dans son ensemble à Toulouse et comme partout en France. On nous fera le crédit que cette affirmation n’est pas nouvelle pour nous. Nous la défendons depuis longtemps pour la France comme pour tous les pays européens (la Grèce, en particulier) qui ont subi les ravages de la désindustrialisation.
« Nous payons aujourd’hui l’incroyable défaillance industrielle de la France »
La question qui n’est pas posée dans ce débat est bien celle de la place de l’industrie dans nos sociétés, son acceptabilité ainsi que sa finalité. La filière aéronautique est restée malgré tout très localisée autour des avionneurs, alors que l’automobile s’est largement délocalisée. Le lien reste étroit (et non Détroit) entre cette filière et les territoires en proximité de la région toulousaine, puisqu’un véritable ancrage territorial s’est construit, notamment autour de compétences spécifiques. En effet, depuis les années 80, un écosystème unique au monde a été constitué à Toulouse faisant intervenir et créant des interdépendances singulières entre petites et grandes entreprises, institutions, établissements d’enseignement supérieur, instituts de formation etc.
Un grand plan de développement territorial conséquent pour Toulouse demain ne doit ni omettre tout cela, ni rester figé. Il s’agit désormais de prendre en compte les mutations de l’appareil industrialo‐serviciel aéronautique et de développer de nouvelles filières, qui pourraient s’appuyer sur un redéploiement de certaines de ces compétences à des fins de production à haute valeur ajoutée et de durabilité.
Le rôle des actionnaires et celui des communautés de travail
Les quatre auteurs nous citent à propos des nombreux acteurs du secteur économique toulousain (banques, partenaires institutionnels, structures de la recherche et de l’innovation, entreprises du secteur de l’aéronautique et du secteur aérien) et lorsque nous mettons, selon eux, en exergue « cet écosystème complexe qui développe l’ensemble de la valeur d’échange mais aussi d’usage d’un avion. Il ne se réduit donc pas à l’assemblage final sur les chaînes d’Airbus ».
Et les quatre auteurs d’ajouter que « c’est donc bien cet agrégat qui fait système (écosystème comme système économique et non pas système écologique…). Nous ne le nions pas. Mais cela décrit, explique la situation présente que nous dénonçons. De là d’ailleurs à parler de « communauté de travail » comme le font les auteurs de la tribune, nous parlerions nous plutôt de chaîne de fabrication de profit… ».
Par « communauté de travail », nous avons voulu désigner ni l’écosystème évoqué plus haut, ni a fortiori les actionnaires, mais les dispositifs qui rassemblent les salarié(e)s des différents sites d’Airbus en précisant la signification que revêt cette communauté aujourd’hui.
Soyons plus précis afin de tenter d’éviter que ne perdurent les confusions. Dans notre précédent texte, nous avions rappelé que la CGT avait initié depuis plusieurs années une coordination entre syndicats du donneur d’ordre (Airbus) et de ses sous‐traitants.
Allons plus loin puisque, sans doute par méconnaissance, les quatre auteurs raillent la notion de « communauté de travail ». Il n’est ainsi peut‐être pas inutile de rappeler que la CGT Airbus (comme dans d’autres entreprises) a, sur la durée, tenté par tous les moyens, notamment judiciaires, de faire reconnaître l’utilité du travail des salariés invisibles, dénommés les « travailleurs mis à disposition ». Cette reconnaissance des travailleurs mis à disposition a interpellé le monde syndical comme politique et a fini par trouver un débouché législatif en étant inscrite dans la loi dite de « Modernisation sociale » de 2008.
« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Cet article, tiré du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 issu du programme national de la résistance (les jours heureux), a fondé la position du Conseil constitutionnel permettant de trancher la question de la représentation des travailleurs mis à disposition, des salariés sous‐traitants in‐situ en langage courant, lors des élections professionnelles.
Par extension, la CGT Airbus, forte de cette logique, a souhaité unifier tous les salariés qui avaient la même finalité : participer à la fabrication d’un Airbus, qu’ils soient salariés directs d’Airbus ou salariés des sous‐traitants.
Alors, certes, la reconnaissance d’une communauté de travail n’empêche pas la « fabrication de profit » mais pour l’heure, dans notre société, c’est le lot de presque tous les salariés, quels que soient leur domaine d’activité. Et ce n’est pas une mince avancée, selon nous, que la reconnaissance de cette « communauté de travail » qui permet désormais sans équivoque de pouvoir rendre visibles les travailleurs invisibles en leur donnant pour cela un cadre reconnu par la loi. Cette communauté de travail pourrait être le socle d’une implication collective des travailleurs d’Airbus par‐delà de leur dispersion sur les différents sites de l’avionneur.
« Et les actionnaires là‐dedans ? », s’interrogent les quatre auteurs et de poursuivre : « Pour être bref, nous pouvons (il faut) nous en passer. Le profit, le versement de dividendes n’ont rien à voir avec l’utilité sociale de la production de richesses. Ils sont même un obstacle à la reconversion industrielle et portent en eux le désastre qui s’annonce ».
Pour notre part, il ne nous revient pas de défendre la bourse et les marchés financiers. Mais « supprimer la bourse » ouvre un débat qui dépasse le nôtre. Militons plutôt pour interdire les pratiques qui sont celles du capitalisme financiarisé : versements de dividendes mêmes lorsque les entreprises font des pertes, rachats d’actions, stock‐options, optimisation fiscale, etc. Et militons pour rassembler les travailleurs et imposer une autre gouvernance comme le font certains syndicats, des militants associatifs et aussi des intellectuels comme Olivier Favereau ou François Morin.
En revanche, disons‐le tout de suite même si nous reviendrons plus amplement sur cette question centrale dans la seconde partie de notre contribution : nous partageons pleinement l’idée que c’est la mobilisation des salarié(e)s et des citoyen(ne)s, en d’autres du mouvement social, qui seule peut transformer la promesse de changement potentiellement contenue dans la crise actuelle en changement effectif dans le sens de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un nouveau modèle de développement.
Alors Toulouse, un pays de cocagne, vraiment ?
Pour terminer cette sorte d’inventaire de nos désaccords, évoquons à présent l’intitulé de la dernière tribune de nos amis, toujours sous forme d’interrogation. Et redonnons‐leur la parole : « Pour jouer dans la comparaison, historique cette fois, c’est un avenir à la mode « pastel » qui attend Toulouse (quelques dizaines d’années de richesse ‑mais pour certains seulement‐ puis l’effondrement), pas un pays de cocagne… Au moins, la bourgeoisie enrichie de l’époque nous a laissé de magnifiques hôtels particuliers. Pas des bâtiments en bac acier, fût‐il double peau… ».
Et nos amis de considérer que nous avons, dans notre précédente contribution, utilisé un « argument un peu fallacieux ». Ce, en considérant dans le texte « Toulouse, un nouveau Detroit ? », que « ce seraient des dizaines de milliers d’emplois qui seraient en jeu » et en écrivant alors de notre côté : « (…) n’emboîte-t-on pas ainsi le pas à certains des dirigeants d’entreprises aéronautiques qui pourraient être tentés de se saisir de la crise actuelle pour légitimer des suppressions d’emplois qui devront plus à la financiarisation des stratégies qu’à un recul posé comme inéluctable de la production ? Ne prenons‐nous pas le risque de pousser à la « consolidation » – en d’autres termes, à la concentration – du secteur ? ».
Et nos amis de s’irriter : « Nous contestons cette affirmation (même formulée de manière interrogative) car, au‐delà de minimiser la crise en cours, elle revient à rendre complice (ne serions‐nous que des idiots utiles ?) du processus de concentration possible du secteur ceux qui s’interrogent sur la situation de l’aéronautique et qui remettent en cause tant l’organisation de la production que son utilité et sa finalité. On retrouve ici les mêmes schémas de pensée qui transforment les antinucléaires en suppôts de l’industrie pétrolière… Les vieux anathèmes ne sont pas morts ».
Nos amis de compléter : « Ajoutons que nous ne remettons nullement en cause l’existence d’un secteur économique consistant à fabriquer des avions ; et que nous reconnaissons l’excellence toulousaine en la matière ; et celle‐ci vient de loin. Là n’est pas le problème. Ce que nous mettons en perspective et nous le redisons, ce sont les prévisions, aujourd’hui erronées, de croissance « sans fin » du secteur telles qu’elles étaient jusqu’à récemment annoncées ».
Et de conclure : « Quant à la référence à Detroit qui semble irriter les auteurs de la tribune de Mediacités, il convient de noter la forme interrogative de l’accroche de notre texte « Toulouse, un nouveau Detroit ? » ; et de souligner que nous voulions, par cette accroche, interpeller le plus grand nombre. Objectif atteint d’ailleurs. Bien sûr, comparaison n’est pas raison, nous en convenons ; mais analyse des similitudes et analogies sont souvent le support à des démarches qui permettent de sortir des rails convenus de la pensée dominante (…) ».
Afin de répondre à nos quatre auteurs, disons que nous considérons comme une maladresse de comparer, fût‐ce avec des points d’interrogation, Toulouse de demain aussi bien à Detroit qu’au pays de cocagne du millénaire passé. Comme nous l’avons écrit, « comparaison n’est pas raison » et de telles comparaisons sont non seulement faciles et infondées mais dangereuses. Nous regrettons également l’usage du mot « effondrement », mot à la mode mais qui résigne et finalement dépolitise, car il suggère inévitable ce à quoi il se réfère. Ainsi, ces comparaisons peuvent, en effet, donner à penser que l’avenir de l’aéronautique est derrière elle et que la dépendance de la ville à ce secteur condamne les deux d’un même tenant. Il n’en est rien. D’une part, parce que nous considérons que l’aéronautique a les possibilités de se réinventer à condition que celle‐ci soit considérée comme un bien commun de tous les toulousain(e)s et de ses salarié(e)s en premier lieu. D’autre part, parce que la ville dispose d’autres atouts que celui de l’aéronautique, même si celui‐ci en est un, qu’elle doit contribuer à le faire évoluer dans le sens de la transition écologique, au regard de sa production et de ses usages.
Nos propositions
Les auteurs de la tribune publiée sur le site de l’Université Populaire considèrent que les dix propositions que nous faisons « privilégient une approche que l’on peut qualifier « d’institutionnelle » ». Et de préciser : « Elle a sa raison d’être et nous ne la remettons pas en cause pour ce qu’elle est, mais pour sa dépendance à une vision très technocratique ».
Nous ne voyons pas vraiment ce que nos amis entendent par « institutionnelle » et « technocratique », si ce n’est pour nous renvoyer à une posture de modération et de continuité qui nous est étrangère.
Ici, nous laisserons le lecteur juger par lui‐même en lui laissant le soin d’activer le lien vers notre précédente tribune et en lui suggérant d’aller à la fin de notre texte pour prendre connaissance de nos propositions.
Parmi les dix propositions que nous faisons, nous rappellerons juste ici le principe de conditionnalité de toute aide publique. Aucun soutien ne doit être accordé au secteur du transport aérien ou au secteur aéronautique qui ne soit conditionné par des engagements précis en matière de transition écologique. Les pouvoirs publics doivent également non seulement protéger les intérêts des salariés mais peser de tout leur poids pour faire évoluer les dispositifs de gouvernance de façon à ce que les salariés, ceux qui par leur travail ont su créer les conditions de l’envol de cette belle industrie, soient désormais en mesure de participer à l’élaboration des décisions stratégiques.
Pourquoi d’ailleurs, l’État actionnaire, dans le cadre de l’adoption récente de la loi Pacte, n’imposerait-il pas à Airbus de se transformer en « entreprise à mission » ? Un tel statut, désormais envisageable par la loi, suggérerait qu’Airbus ne devrait plus être considéré une simple entreprise « normale », c’est-à-dire uniquement guidée par l’intérêt de ses actionnaires, mais une entreprise dont les missions seraient élargies pour pleinement prendre en compte les enjeux environnementaux et sociétaux et se comporter avec les responsabilités qui sont celles d’une entité stratégique au service de la souveraineté de la France et de l’Europe.
Nos accords, à présent
La publication de l’Université Populaire indique : « Nous ne voyagerons plus comme avant, en volume comme en distances. Le modèle low‐cost, modèle dominant du secteur du transport aérien sur lequel s’est appuyée la progression de ce secteur – et en conséquence le nombre d’avions commerciaux fabriqués (ou à fabriquer) – est en train d’être profondément remis en cause ».
Nous sommes pleinement d’accord. Et nous étendons le raisonnement sur l’ensemble de l’industrie. Si le low‐cost a pu s’étendre dans tous les pays, c’est parce qu’une certaine idéologie de la société de consommation a pu se répandre à partir du début des années 1970 et c’est aussi parce que le pouvoir d’achat des ménages a partout subi les effets de l’austérité et ceux de la déflation salariale. Accroître les revenus n’est pas seulement une affaire de justice sociale, c’est aussi une question d’efficacité économique car avec des revenus plus élevés, nul doute que les ménages pourraient se procurer des produits de meilleure qualité, plus durables, qui sont précisément ceux que l’on peut et doit produire dans des pays comme la France.
Dans le présent texte, l’industrie qui est évoquée est celle de l’aéronautique. Mais il y aurait beaucoup à dire sur celle du prêt‐à‐porter, une des plus polluantes du monde et qui fait travailler des millions de personnes dans des conditions indignes. Et que dire de la « malbouffe » et de ses conséquences sur la santé des humains et ses effets sur la nature ?
La question de la consommation des carburants des avions
Les quatre auteurs écrivent, suggérant un désaccord : « Quant à l’utilisation de produits d’origine végétale, voire même d’huile de cuisine recyclée (le green washing version Mac Donald’s… mis en avant par les multinationales Véolia et BP) qui pourraient être utilisés, pour partie, dans la composition des carburants, on ne peut que rester sceptique quand on sait leur origine (huile de palme en particulier) et leur impact sur la disponibilité des terres arables nécessaires à nourrir la population mondiale ».
Nous avions écrit : « Loin d’être une lubie, l’utilisation de carburant vert pourrait être une solution partielle transitoire dans la mesure où cela n’entraînerait ni compétition avec l’alimentation humaine, ni occupation de foncier agricole ou consommation de ressources en eau ou en biodiversité, comme le propose Green Cross France & Territoires. Mais il est clair que cette solution, à elle seule, ne saurait résoudre la question centrale de la consommation d’énergie des avions ». Où se situe dès lors le désaccord ?
Les possibilités de diversification des acteurs de l’aéronautique
Les quatre auteurs indiquent que nous avons écrit que « Nous considérons que nombre d’acteurs de la filière aéronautique ont les compétences nécessaires pour produire des biens autres que pour cette filière ».
Tout en doutant apparemment de cette proposition, les auteurs rappellent eux‐mêmes l’histoire éloquente de de la SEMM Caravelair, sise dans la région de Saint‐Nazaire : « En 1960, le secteur aéronautique était en crise (…). C’est alors que des projets de diversification voient le jour qui donnent naissance aux réfrigérateurs de marque Frigéavia (et même des téléviseurs Téléavia) et aux caravanes Caravellair (…). Cela nous permet de rebondir sur les perspectives de diversification version changement climatique (…). Imaginons donc la fabrication de lave‐linge et de lave‐vaisselle correspondant aux standards (encore à finaliser) de durabilité (solidité, réparabilité) et de sobriété (en termes de consommation de matières premières, d’énergie, d’eau, de produits de nettoyage). Un appareil électro‐ménager, c’est comme un avion (…). Ils pourraient durer des dizaines d’années et être intégralement recyclés en fin de vie. Pour un peu qu’ils soient low tech (avons‐nous vraiment besoin d’appareils proposant des dizaines de modes et cycles de lavage ?), on pourrait parler de « sobriété heureuse ».
Le chantier qui s’ouvre est donc gigantesque (repenser l’utilité sociale de l’industrie au regard de la crise climatique et de ses conséquences) et passionnant (mobiliser l’intelligence collective des salariés et des habitants) ».
Nous ne pouvons être que d’accord avec cette analyse et ce constat d’un chantier qui est, en effet, essentiel et surtout indispensable.
La croissance de la ville de Toulouse
Les quatre auteurs rappellent les prévisions communément admises de croissance de la taille de Toulouse et de son agglomération : « 550 000 habitants de plus d’ici 30 ans sur le grand bassin toulousain (territoire situé dans un rayon d’une heure autour de Toulouse) dont 300 000 sur la métropole toulousaine pouvait‐on lire dans les prévisions rendues publiques par l’INSEE fin 2019 (…). Ces chiffres donnaient le tournis à beaucoup et ont généré une frénésie notable en termes de grands projets et d’urbanisme (…). Nous le répétons : il faut geler et réexaminer la pertinence de tous les grands projets portés actuellement par la ville de Toulouse et la Métropole. Projets qui étaient déjà critiquables en tant que tels (…). Qui peut encore affirmer que ce seront 550 000 habitants supplémentaires qui viendront résider dans le grand bassin toulousain dans les 30 ans qui viennent ? ».
Nous considérons de concert avec les quatre auteurs que ces prévisions de croissance seront certainement révisées fortement à la baisse et nous ne le regrettons pas. Pour moult raisons, une métropolisation sans limite est, en effet, indésirable. Comme eux, nous considérons que les projets pharaoniques envisagés devront être remisés et qu’une attention très grande devra être portée aux propositions des nombreuses associations qui militent depuis longtemps pour une ville plus humaine.
Ne pas considérer la crise comme un simple accident
Nos quatre auteurs écrivent : « Ne considérer la crise actuelle que comme une simple alerte, un gentil rappel à l’ordre que le système économique dominant (le capitalisme néo‐libéral) absorbera comme il en a déjà absorbé d’autres (la crise financière des années 2008/2009 par exemple). Penser en ces termes est non seulement faire preuve de cécité (…) mais c’est surtout criminel. Le mot peut sembler fort. Mais ce n’est pas la perte des emplois en tant que telle qui nous inquiète, c’est son côté massif (on parle ici de dizaines de milliers d’emplois) qui va générer de la misère sociale avec son cortège de territoires à l’abandon, de villes, villages et quartiers en déshérence, de logements à brader, d’expulsions locatives, de précarité énergétique et alimentaire, de dépressions, de suicides… Ne rien faire quand il en est temps (est‐ce encore le cas ?), c’est considérer que les hommes et les femmes ne sont que des variables d’ajustement, des pions que l’on manipule sur l’échiquier du profit dans le grand marché planétaire du capitalisme ».
Avec les auteurs, nous sommes évidemment inquiets de la misère sociale qui pourrait s’installer si un sens nouveau des activités économiques de la ville et de sa région n’est pas donné. Ce sens est, finalement, assez simple à résumer : partir des besoins des habitants de Toulouse et, d’abord, de ceux qui sont les plus vulnérabilisés en fournissant une réponse sociale et économique s’inscrivant dans la transition écologique.
Compter sur nos propres forces
Les quatre auteurs écrivent : « Les habitants et les citoyens de Toulouse et de son aire urbaine, les salariées des entreprises (et pas uniquement celles de l’aéronautique) sont les premiers concernés (les capitaux, eux, sont flottants et ils iront ailleurs (…). Quelle méthode pour cela ? Il semblerait logique que ceux des salariés les plus conscients de la crise (et ils seront sans doute de plus en plus nombreux) appellent à des assemblées générales sur les lieux de travail, échangent et débattent sur les constats et, pourquoi pas, imaginent ensemble le moyen terme (…). Que produire ? Pour qui ? Comment ? À quelles échéances ? Avec quelle transition (les choses ne se feront pas du jour au lendemain) ? Et cette démarche doit être aussi effectuée dans les quartiers, dans les villes et les villages. Nous sommes tous concernés (…). Nous croyons à l’intelligence collective, à l’auto-organisation des travailleurs et de la population. Ce n’est pas dans le cénacle des dirigeants économiques et politiques que se trouvent les forces vives, les talents, l’intelligence qui permettront de penser et mettre en œuvre l’après ».
Comme les auteurs, nous croyons à l’intelligence collective. Cependant, nous ne pensons pas que les dirigeants politiques et économiques sont tous dans des cénacles, sans intelligence, sans qualités ou nécessairement pervers. Une bonne partie d’entre eux font aussi partie des forces vives. Nous ne sommes néanmoins pas naïfs et affirmons que c’est d’abord la force du mouvement social qui créera le mouvement et en donnera le sens.
Selon les quatre auteurs, « les solutions ne seront pas élaborées par ceux qui ont fait le monde tel qu’il est ». Nous sommes d’accord et c’est dans ce sens que l’aéronautique ne peut être considérée sous l’angle d’un bien privé ou d’un bien relevant de l’État, mais celui d’un bien commun, appartenant à tous les Toulousain(e)s au titre de leur patrimoine vivant.

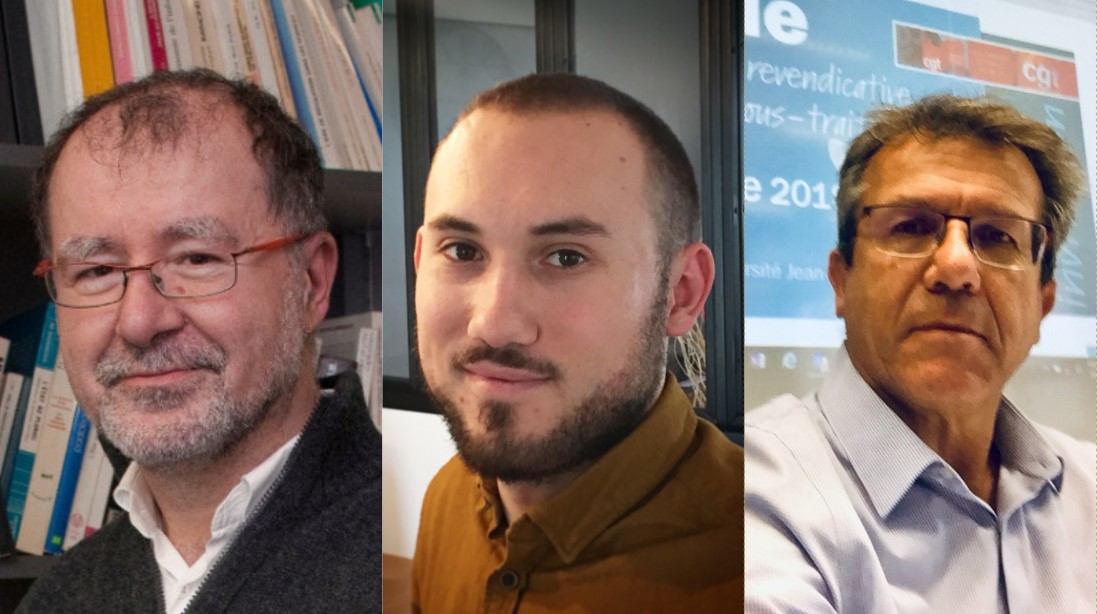
Aucun commentaire pour l'instant